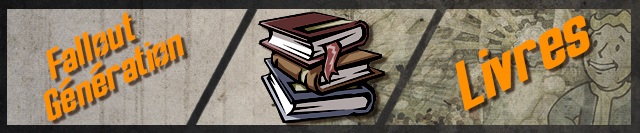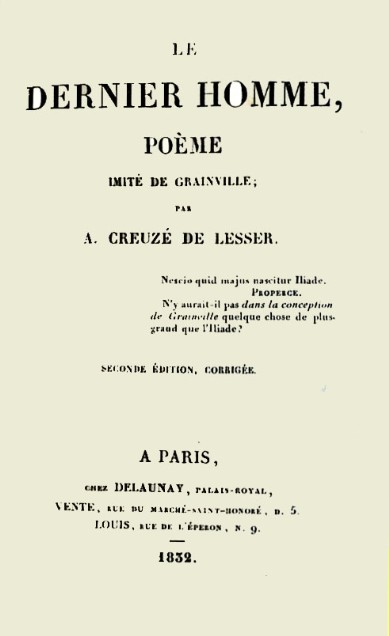Sur l'auteur :
(1771-
Préambule :
Le Dernier Homme, poème imité de Grainville, par Creuzé de Lesser, Chez Delaunay éd., 1832, 1 vol. cartonné, in-
1 ère parution : 1832
le dernier homme -
Synopsis :
«A GRAINVILLE
«Infortuné, qui, vaincu par l’adversité, succombas sans espoir et presque sans nom en laissant un ouvrage plein de génie, accepte l’hommage sincère de l’homme qui a essayé de compléter ce que le malheur ne t’avait pas permis de perfectionner ou d’achever. Il a cherché à monter dans tout son jour le diamant que tu as trouvé, l’œuvre que tu as crée. Il a pu ajouter quelques cordes à ta lyre, mais l’instrument était sublime, et son mérite, ici, s’il en a un, ne sera jamais que l’ombre du tien. » (Envoi ouvrant « le dernier Homme » par Creuzé de Lesser)
Creuzé de Lesser, polygraphe et poète, eut connaissance de l’œuvre de Cousin de Grainville. Stupéfié par sa radicale nouveauté, ému du sort injuste fait à son auteur, et désireux d’ajouter sa contribution au mouvement romantique, il entreprit l’écriture d’une épopée en suivant, au plus près possible, la trame du « Dernier Homme » de Grainville. Cette imitation versifiée du roman fut explicitement proclamée par de Lesser (voir l’envoi liminaire), contrairement à ce que firent plus tard et Elise Gagne, et Flammarion.
Il ne s’agit donc en aucun cas d’un plagiat.
De Lesser pensait notamment que les vers épiques resserreraient l’action. Il garda aussi les mêmes figures emblématiques que sont Dieu, la Mort, Adam, le Génie de la Terre, etc. en modifiant parfois leur distribution. Ce sont surtout les relations entre Sydérie et Omégare qu’il rendit plus étroites, pour les faire coïncider avec le « pathos » de l’amour romantique.
Le poète se désespérait que l’œuvre de Grainville restât ignorée de son public malgré la réédition qu’en fit Charles Nodier, réédition elle aussi discrète et méconnue. Sachant que le Français « n’avait pas la tête épique », De Lesser aligna dans sa composition certaines nouveautés surtout après le Livre III, trouvant la fin du roman moins puissante que le début. Il y mentionna, et pour la première fois dans la littérature française, la théorie des arches stellaires :
« Ormus, par le péril constamment agrandi,
Ouvrit un vœu plus noble, un projet plus hardi :
« le soleil nous trahit aussi bien que la terre ;
Mais tout n’est pas perdu, dit-
Eh bien ! abandonnons, par un heureux conseil,
Cette terre flétrie et ce pâle soleil.
D’un univers vieilli quittons l’antique sphère,
Et cherchons dans l’espace une nouvelle terre,
Sous un soleil nouveau dont les feux triomphans
Vont régénérer l’homme, heureux de ses enfans,
Ces astres que la nuit nous montre sur nos têtes,
Offrent à notre destin mille demeures prêtes.
Car, éloignés en vain, par un art précieux,
Nous les voyons de près, nous les touchons des yeux,
Et pouvons reconnaître à toutes les distances
Les Eden merveilleux de ces déserts immenses.
D’innombrables esquifs, vaisseauxaériens,
Du départ en tous lieux vous offrent les moyens,
Et tout le genre humain, immense colonie,
Peut s’élever bientôt , dans les cieux réunie.
Je sais ainsi que vous que, d’un air trop subtil
Il faut dans ce voyage affronter le péril ;
Mais déjà Philantor, par son art admirable,
A su rendre aux mortels le ciel moins redoutable.
J’y joindrai mes efforts ; et, comme sur les mers
On porte une eau salubre au sein des flots amers,
Ainsi nous pourrions tous, par une heureuse audace,
Munis d’un air vital, franchir un long espace
Jusqu’au jour qui verrait le genre humain vainqueur
Respirer librement sur un sol bienfaiteur.
Naviguons dans les cieux vers ces terres fécondes,
Venez, venez choisir dans le peuple des mondes.
Vous voulez, en fuyant reculer vos revers :
Bravez-
« A l’occident lointain, des jours l’astre brillant
Disparaissait : soudain du lointain orient
S’avance une clarté plus vive que l’aurore,
Et qui croît par la nuit, et qui s’accroît encore.
Un vaste feu, du ciel semble le vêtement ;
La terre réfléchit l’éclat du firmament ;
Tout paraît enflammé, même la froide plante ;
Et tout homme paraît une flamme vivante.
L’homme, à ce redoutable et pompeux appareil,
Croit voir sur l’horizon naître un nouveau soleil,
Ou croit voir, en ce feu dont la clarté l’inonde,
La flamme universelle où périra le monde.
La lune, en s’approchant des mortels malheureux,
Seule causait ce trouble, hélas trop douloureux.
Elle se lève enfin, et sanglante, et farouche,
Présentant aux mortels une effroyable bouche…
Ouverte, et d’où le feu jaillissait par torrens.
Alors des animaux les cris sont déchirans ;
Et leur prince lui-
L’homme, contre la terre a caché son visage.
Presque seul, Philantor ne trembla pas comme eux ,
Et sur la lune encore osa lever les yeux.
Lorsque d’un œil tranquille il l’a considérée,
Il dit que d’un volcan la lune est décorée.
Observant l’incendie, en observant la fin,
Il annonce aux mortels le ciel rendu serein.
« Regardez, leur dit-
De vos antiques nuits ne cherchez plus la reine.
Cet astre a terminé le cours de ses travaux.
Il a péri. Sa cendre est rendue au chaos,
Et doit, un jour lointain que rien ne nous révèle,
Former les élémens d’une terre nouvelle. »
Aujourd’hui, l’épopée de Creuzé de Lesser est inaccessible, oubliée, enterrée, comme l’est le roman qui lui a donné naissance. L’épopée n’est plus au goût du jour et il est vrai que le lecteur moderne ne peut se sentir à l’aise dans l’air stimulant des hauts sommets alors qu’il a pris l’habitude d’avaler la soupe épaisse de la médiocrité littéraire dont les médias, à longs traits, l’abreuvent constamment.
Bref, les mauvaises habitudes ont la vie dure et, avec la mutation rapide de notre langue, le moment n’est plus très loin où nos contemporains, non seulement ne comprendront plus ce qu’à voulu dire Creuzé de Lesser, mais n’arriveront même plus à en déchiffrer le poème.
Dors en paix, ô Dernier Homme, dans le cimetière littéraire français !